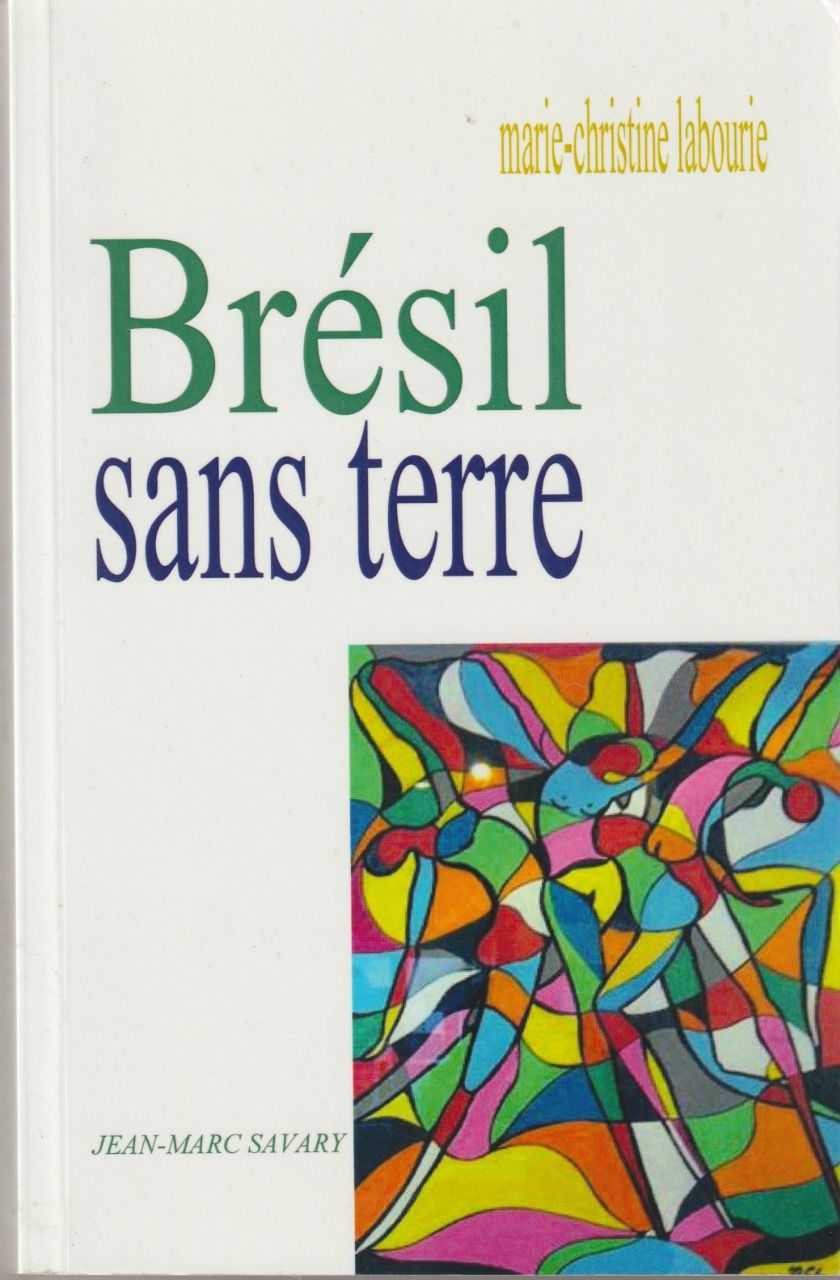BRESIL SANS TERRE
Brésil sans terre est un roman de Marie-Christine LABOURIE qui a obtenu le :
PRIX DU PUBLIC, PLUMES DE FEBUS
Festival du livre d'Orthez.
Claude, européenne, découvre le Brésil. Loin des clichés pour touristes, elle rencontre les habitants de la favela, le bidonville des «sans terre »… De la misère née la colère et l’envie de reprendre un destin en main. Celui d’être paysan, loin des promesses vaines et des corruptions de tous bords, quitte à entamer une lutte sans merci. Claude, impliquée dans la dureté de ce pays, se révèlera à elle-même. Véritable quête initiatique pour cette femme enquête de l’homme qu’elle aime…
LES PREMIERES PAGES DE BRESIL SANS TERRE :
CHAPITRE I
Il fait encore nuit.
Un léger roulis annonce les courbes de la descente. L’oppression s’installe, juste là, à la pointe du cœur. Claude a la sensation de flotter, endolorie par l’émotion et la fatigue. Elle voudrait retrouver la pesanteur, jouir pleinement de l’instant, goûter la joie de l’arrivée. Elle a pourtant vaincu les vagues et parcouru le ciel, jusqu’au bout. Le Sud, enfin, l’accueille, mais une onde inquiétante lui broie les mains et entrave son souffle.
Le visage de Pancho scrute par le hublot les premières lumières de la terre. Ce visage qu’elle n’ose frôler… il se découpe sur une ligne d’horizon qui tangue, ourlée de lucioles hésitantes. L’avion rétablit son équilibre, ramenant doucement l’épaule de Pancho contre la sienne. Elle frémit, une rafale dans les hanches…
-Regarde… Claude ! Regarde… Ma terre, mon Sud…
Et dans un souffle il ajoute :
-Enfin… presque ma terre…
L’avion se glisse vers le sol, tressaille et s’immobilise. Ils sont arrivés. Mais rien n’est accompli.
Sur la passerelle, l’air tiède les enveloppe soudain et un vent doux qui agace les palmiers glisse sur les cuisses de Claude. L’aéroport est déjà plein de rumeurs. Virginia les attend. C’est une superbe jeune femme. Ses cheveux roux encadrent un visage brun, aux yeux de feu. Claude, intimidée, accueille un peu crispée les embrassades chaleureuses.
-C’est comme ça chez nous, lui lance Pancho.
Elle observe les retrouvailles bruyantes des deux amis qui se sont connus à l’université de Santiago et dont la conversation lui échappe car ils alternent espagnol et portugais.
Elle les suit, somnolente, légèrement contrariée, jusqu’au bar où ils attendront l’autobus. La ville s’éveille. Les premiers rayons de soleil dévoilent des rues sans trottoirs, des façades grises. Elle perçoit des interpellations, des bribes de phrases et le roulement doux d’une langue chaloupée qui chuinte, glisse sur les portes jaunies, le bleu délavé des murs et flâne sur les tables de fer des bistrots. Le macadam est troué d’ornières. De gros camions commencent à rugir sur la chaussée et font gémir leurs amortisseurs dans une poussière ocre.
L’autobus est là, pataud, déjà écrasé de bagages et lacéré de grandes écorchures de rouille. Claude remarque un peu inquiète les plages brillantes d’un pneu lisse… La masse obèse finit par s’ébranler et s’arrache lentement du bas-côté poussiéreux. Bientôt on file entre les interminables ondulations des champs de canne à sucre… Claude, éreintée par le décalage horaire, a renoncé à suivre la conversation animée entre Pancho et Virginia. Ils font pourtant quelques efforts pour lui parler en français, lui désigner les villages de torchis aux chemins ravinés et les fazendas[1]cossues. Mais le sommeil finit par l’emporter. A peine aperçoit-elle, avant de sombrer, les femmes et les enfants nus pieds qui forment, avec quelques bœufs maigres, une procession brune tout au long de la route.
A l’arrivée, la ville est en ébullition. Claude se voit bousculée, soulevée et terrorisée par une foule en effervescence qui danse, chante et scande des slogans. Elle perd un moment ses compagnons et va s’échouer contre les affiches murales de la campagne électorale. Elle aperçoit Pancho détendu dans le vacarme. Il vient vers elle avec un sourire qu’elle ne lui connaissait pas… Il est enfin heureux, dans cette cacophonie truculente et lui crie :
-Une campagne électorale libre ! Tu entends ? Libre ! La première depuis vingt ans…[2]
Elle sourit faiblement, ne sachant partager cet enthousiasme, à nouveau exclue…
Ils parviennent enfin dans le petit appartement de Virginia, presque sordide… Mais elle ne voit rien et n’aspire qu’à dormir. Elle s’écroule, sans avoir dit un mot, sur le canapé élimé.
Le lendemain, dans un sursaut de fierté, elle annonce qu’elle veut affronter la ville, seule. Pancho esquisse un vague sourire… La voilà traversant pour la deuxième fois le même terrain vague.
Elle s’égare entre les colonnades baroques et bas-côtés boueux, évite un défilé bruyant qui suit une voiture poussive pourvue de huit haut-parleurs. Le nom du candidat propulsé par les micros se perd dans un brouhaha énorme qui l’effraie… Des bâtisses imposantes, flanquées de balcons portugais dont la splendeur passée est rongée par l’humidité, longent les avenues… De grands bâtiments de verre jouxtent les terrains vagues. Et des chemins de terre s’échappent du macadam, comme pour se cacher, vers des baraques de planches… Elle marche, revient sur ses pas, cherche en vain : elle doit en convenir, elle s’est complètement perdue ! Des passants attentionnés veulent lui venir en aide, mais elle se trouble, remercie à la hâte le nez baissé et fonce, honteuse, dans une direction approximative… Depuis une heure, elle cherche son chemin. Sa robe adhère à son corps trempé de sueur. Sa nuque devient lourde et une sourde angoisse rampe dans sa gorge lorsque pour la cinquième fois elle se voit accostée par un enfant. Il s’approche, tout près, elle ralentit sa marche… Il faut éloigner le malaise, fouiller son sac, tendre la main vers la menotte brune qui se tend et donner encore, dégouté de soi-même…
Elle repart, irritée, dans une ville qu’elle commence à détester… Une silhouette brune et osseuse, surmontée d’un énorme ballot, s’approche à grands pas dans sa direction… Elle voudrait fuir. Mais la femme est déjà là, plantée devant elle, le regard dur. La main noueuse attend pendant d’interminables secondes et se découpe sur l’ocre clair de la terre battue. Le regard de Claude remonte le long du bras malingre, passe sur le cou ridé et heurte de plein fouet un visage noirâtre. C’est une vieille femme, figée, qui la fixe sans un mot. Tout en elle dégage une inquiétante énergie qui pétrifie Claude. La main immobile attend toujours… Un Volkswagen passe en trombe, déchire le silence. Claude croit voir cette main s’élever sur elle et battre l’air. Mais rien n’a bougé.
-Je ne peux plus.
Elle fait volte-face et fuit. Les vociférations de la femme couvrent à peine le vacarme de son cœur. La vieille hurle, l’insulte, lui jette des sorts. Claude se retourne au moment même où la pierre atteint sa cheville. Une douleur aiguë assaille sa jambe. Elle vacille sous l’éclat noir du regard.
Elle court maintenant, petite fille fuyant les pages d’un mauvais conte. Elle cherche la mer, en proie à une énorme colère qui décuple sa douleur, tandis que la silhouette essoufflée balbutie des malédictions qu’elle croit saisir :
-Souviens-toi de moi, salope d’Amerloque, je m’appelle Lourdes !
La mer est enfin là… Le corps meurtri, Claude s’affale sur le sable.
-J’ai trente ans et j’ai peur de tout…
Elle écoute son propre souffle se mêler à celui des vagues tandis qu’une phrase obsédante martèle sa conscience : « A qui la faute ? »
Au loin un paquebot se traîne dans la brume. Elle revoit le pont de pierre de Bordeaux… Il déroule ses arches dans les courbures des nuages. Mais la mer ce soir reste terne. Pourquoi l’a-t-elle traversée ?
C’est en se relevant qu’elle reconnaît sur l’avenue le balcon de Virginia.